- Introduction : De la fin de l’histoire à la polycrise
- Partie 1 : L’ordre en décomposition (2001-2025) : Anatomie d’une polycrise
- Partie 2 : Les trois fractures qui érodent la stabilité mondiale
- Partie 3 : Un plan pour une nouvelle ère : les percées proposées
- 3.1 Proposition 1 : L’Accord de stabilité économique mondiale (GESA) — Un cadre du XXIe siècle pour une coexistence gérée
- 3.2 Proposition 2 : Une feuille de route basée sur la performance pour la réintégration de la Russie
- 3.3 Proposition 3 : L’initiative pour les biens communs numériques et le bouclier mondial de cybersécurité
- Conclusion : De la concurrence sans contrainte à la coexistence gérée
Introduction : De la fin de l’histoire à la polycrise
Le premier quart du XXIe siècle (2001-2025) restera dans les mémoires comme une ère de déconstruction systématique de l’ordre international de l’après-guerre froide. La vision initialement optimiste d’un avenir apporté par la mondialisation s’est transformée en la réalité d’une « polycrise », où les chocs géopolitiques, économiques et technologiques interagissent, se répercutent en cascade et s’amplifient mutuellement. Alors que la guerre froide avait une structure claire basée sur la confrontation idéologique Est-Ouest, la communauté internationale est à la recherche d’un nouvel ordre depuis sa fin. Cependant, cette recherche est restée sans conclusion, et le monde est entré dans une nouvelle ère d’instabilité.
La thèse centrale de ce rapport est que le défi principal auquel le monde moderne est confronté réside dans la divergence croissante entre un système économique mondial hautement intégré et un paysage géopolitique de plus en plus fragmenté. Le but de ce rapport est de proposer une architecture intégrée pour gérer cette divergence et passer d’un cadre de concurrence désordonnée à un cadre de « coexistence gérée ».
Pour atteindre cet objectif, ce rapport présente un ensemble intégré de « percées » se renforçant mutuellement, conçues pour remédier aux trois fractures majeures de l’ordre international contemporain. Basées sur une analyse historique de 2001 à 2025, ces propositions visent à fournir des prescriptions concrètes et réalisables pour les défis complexes de notre temps.
Partie 1 : L’ordre en décomposition (2001-2025) : Anatomie d’une polycrise
Cette section fournit une analyse historique essentielle, retraçant les événements clés et les changements structurels qui définissent l’environnement mondial contemporain. L’objectif est d’éclairer la chaîne de causalité menant d’une ère d’unipolarité à l’état actuel de confrontation multipolaire.
1.1 Le choc du 11 septembre et la surextension unipolaire (2001-2008)
Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont fondamentalement transformé le paysage de la sécurité internationale. L’attention mondiale s’est déplacée des conflits interétatiques vers une lutte contre des acteurs non étatiques — la « guerre contre le terrorisme ». Si cet événement a fourni une justification à l’action unilatérale américaine, il a également stimulé une coopération internationale sans précédent en matière de lutte contre le terrorisme, conduisant à la création de nouveaux cadres juridiques. Les Nations Unies, par exemple, ont imposé aux États membres d’adhérer à des traités multilatéraux de lutte contre le terrorisme, démontrant un moment de solidarité internationale.
Cependant, la réponse au 11 septembre, en particulier les guerres en Afghanistan et en Irak, a considérablement épuisé les ressources militaires et économiques des États-Unis. Cela a détourné l’attention et les capitaux d’autres problèmes mondiaux urgents, accélérant ainsi un déplacement relatif de l’équilibre mondial des pouvoirs.
Les événements de cette période ont créé un profond paradoxe dans l’ordre international. À court terme, la menace commune du terrorisme a favorisé la coopération multilatérale. Pourtant, la réponse stratégique américaine ultérieure — guerre préventive et action unilatérale — a finalement affaibli les normes et institutions internationales mêmes que les États-Unis avaient longtemps défendues. Ce comportement, associé à la tendance plus large de la mondialisation à diminuer le statut des États souverains, a remis en question la structure du droit international. Le précédent créé par les États-Unis d’appliquer sélectivement l’« ordre fondé sur des règles » a créé un vide normatif que des États révisionnistes comme la Russie exploiteraient plus tard pour affirmer leurs sphères d’influence et justifier des actions en dehors du cadre existant du droit international. Ainsi, l’ère de la « guerre contre le terrorisme » a semé les graines des défis géopolitiques des années 2020.
1.2 La crise financière et la montée de la géoéconomie (2008-2016)
La crise financière mondiale de 2008, issue du problème des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, s’est propagée à travers le monde avec l’effondrement de la grande banque d’investissement Lehman Brothers. Cette crise a révélé un échec catastrophique du modèle financier occidental, portant gravement atteinte à la confiance en son leadership économique. Après la crise, les économies avancées sont entrées dans une période de stagnation à long terme caractérisée par des taux de croissance plus faibles, des investissements en capital réprimés et une croissance de la productivité atone.
En revanche, la Chine a réalisé une reprise rapide grâce à un plan de relance massif mené par l’État, s’imposant comme le principal moteur de croissance de l’économie mondiale post-crise. Cet événement a accéléré de manière décisive le déplacement du centre de gravité économique mondial vers l’Asie, en particulier la Chine. Au cours de la réponse à la crise, le G20 est devenu le principal forum de gouvernance économique mondiale, reflétant la nouvelle réalité multipolaire. Cependant, le G20 a eu du mal à passer d’un organe de réponse aux crises à un comité de pilotage proactif, exposant les difficultés de recherche de consensus entre diverses puissances économiques.
La crise financière de 2008 n’était pas simplement un événement économique, mais un tournant géopolitique. Elle a sapé la légitimité du modèle fondamentaliste de marché représenté par le « Consensus de Washington » et a conféré de la crédibilité aux modèles de capitalisme d’État comme celui de la Chine. Cela a donné naissance à une nouvelle arène de concurrence connue sous le nom de « géoéconomie », où les instruments économiques tels que le commerce, l’investissement et la politique monétaire sont devenus des outils centraux du pouvoir de l’État. L’interdépendance économique, autrefois considérée comme une source de paix, s’est transformée en un vecteur potentiel de conflit. La Chine a commencé à tirer parti de sa puissance économique accrue à des fins stratégiques, en étendant son influence par le biais d’initiatives telles que la « Nouvelle route de la soie » et en intensifiant les frictions commerciales et technologiques avec les États-Unis.
1.3 Le retour de la puissance dure et la fragmentation systémique (2016-2025)
Cette ère est caractérisée par la résurgence de la concurrence entre grandes puissances. Les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et sous sa forme la plus aiguë, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, sont emblématiques de cette tendance. L’invasion a été un défi direct aux pierres angulaires de l’ordre international de l’après-Seconde Guerre mondiale — la souveraineté nationale et le non-recours à la force — et a entraîné des sanctions économiques sans précédent contre la Russie. Cela a forcé un réalignement des marchés mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires, portant un coup dur à l’économie mondiale.
La pandémie de COVID-19 concomitante a agi comme un catalyseur, accélérant cette fragmentation. La pandémie a révélé les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales, stimulant les mouvements vers la « résilience », la « relocalisation » et le « friend-shoring ».1 En particulier, la prise de conscience s’est accrue concernant les risques posés par le rôle dominant de la Chine dans les secteurs critiques et la dépendance excessive à son égard.2
Les événements de cette période ont révélé que le système mondial fonctionne selon deux logiques divergentes. Le « système d’exploitation » de l’économie mondiale reste profondément intégré par le biais des chaînes d’approvisionnement et de la finance, tandis que le « système d’exploitation » de la géopolitique se fragmente en blocs concurrents. La guerre en Ukraine est la manifestation la plus violente de cette scission, forçant les États et les entreprises à privilégier l’alignement géopolitique par rapport à l’efficacité économique. Si la pandémie a démontré la « vulnérabilité » des chaînes d’approvisionnement centrées sur la Chine, la guerre en Ukraine a prouvé que l’interdépendance économique pouvait être « militarisée » par le biais de sanctions. La combinaison de ces événements a provoqué un recalcul stratégique mondial, passant d’une rationalité purement économique à la logique de la sécurité et de la résilience.
1.4 Les accélérateurs numériques et climatiques
Une autre tendance critique définissant ce quart de siècle est l’évolution exponentielle de l’intelligence artificielle (IA). L’IA est passée d’une technologie de niche à une technologie à usage général, promettant des gains de productivité spectaculaires tout en posant de profonds défis à l’emploi, à la cohésion sociale et à la sécurité.
Simultanément, l’aggravation de la crise climatique est devenue une priorité internationale absolue, créant de nouvelles arènes de coopération et de conflit. Des politiques comme le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE sont des tentatives pour empêcher la « fuite de carbone », mais sont considérées par d’autres nations comme une forme de protectionnisme environnemental, devenant une nouvelle source de différends commerciaux.
L’IA et le changement climatique ne sont pas des questions distinctes, mais des accélérateurs systémiques. L’IA remodèle les moyens de production et de pouvoir, tandis que le changement climatique remodèle l’environnement physique et économique lui-même. Ces facteurs créent de nouveaux domaines de concurrence non traditionnels — tels que la course à la domination des plateformes d’IA ou l’établissement de normes pour les technologies vertes — ajoutant de nouvelles couches de complexité au système international.
Partie 2 : Les trois fractures qui érodent la stabilité mondiale
Cette section fournit une analyse détaillée des trois domaines problématiques spécifiques identifiés dans la requête de l’utilisateur, en s’appuyant sur les enseignements de la première partie et en exploitant des données approfondies.
2.1 Le moteur du déséquilibre : asymétries économiques et pensée à somme nulle
La « course pour une part du gâteau » qui préoccupe l’utilisateur est un symptôme de déséquilibres structurels profonds entre les grandes puissances. Cette analyse décortique les modèles économiques divergents des principaux acteurs.
- États-Unis : Une économie axée sur la consommation, dépendante du statut du dollar comme principale monnaie de réserve, enregistrant des déficits commerciaux et courants persistants.
- Chine : Un modèle axé sur l’investissement et l’exportation, tiré par une politique industrielle dirigée par l’État, un système de taux de change géré et un rôle central dans la fabrication mondiale, générant des excédents commerciaux massifs.
- UE, Royaume-Uni, Japon : Des économies matures confrontées à des vents contraires démographiques et à des défis de compétitivité industrielle à des degrés divers, souvent positionnées entre les pôles américain et chinois. Le Japon, en particulier, souffre de décennies de stagnation des salaires malgré une productivité élevée dans certains secteurs.
L’outil des taux de change a ses limites. Ce rapport soutient que si les ajustements monétaires sont nécessaires, ils sont insuffisants à eux seuls. Une analyse de la Banque des règlements internationaux (BRI) montre que l’approfondissement des chaînes de valeur mondiales (où les importations sont des biens intermédiaires pour les exportations) a émoussé l’impact des fluctuations des taux de change sur les balances commerciales.3 Parce que l’économie chinoise est si profondément intégrée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, une dépréciation du renminbi augmente également les propres coûts de production de la Chine, limitant son avantage concurrentiel.
La nature de la concurrence ne concerne pas seulement le prix, mais des stratégies économiques fondamentalement différentes, soutenues par l’État. Des études de cas de politiques industrielles réussies et infructueuses 4, et les différends en cours à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les entreprises publiques, illustrent clairement ce point.
Le cœur de la fracture économique n’est pas simplement un déséquilibre commercial, mais un « choc des capitalismes ». Un modèle de marché libre et un modèle de capitalisme d’État opèrent sur la même scène mondiale avec des règles et des objectifs fondamentalement différents. Cette situation crée des frictions systémiques qui ne peuvent être résolues par les seuls mécanismes du marché ou par de simples outils politiques. Reconnaître cette divergence et créer un nouveau cadre pour négocier ses interactions est essentiel. Les différends sur les droits de douane et les subventions montrent que cette « course pour le gâteau » est déjà une réalité. Un simple réalignement monétaire comme l’Accord du Plaza n’est plus suffisant, car les chaînes d’approvisionnement intégrées compliquent ses effets.3 Le vrai problème est la différence systémique sous-jacente entre un système économique qui privilégie la valeur actionnariale à court terme et la consommation (États-Unis) et un système qui privilégie la capacité industrielle à long terme dirigée par l’État et la part de marché (Chine). Par conséquent, les solutions doivent aller au-delà des mesures financières et aborder les règles de la concurrence industrielle elle-même.
Tableau 1 : Tableau de bord économique comparatif des grandes puissances (2001-2025)
|
Indicateur |
Pays/Région |
2001 |
2006 |
2011 |
2016 |
2021 |
2024 (Prévision) |
|
Croissance du PIB réel (%) |
États-Unis |
1.0 |
2.7 |
1.6 |
1.7 |
5.9 |
2.5 |
|
|
Chine |
8.3 |
12.7 |
9.6 |
6.8 |
8.1 |
5.0 |
|
|
UE (Allemagne) |
2.1 |
3.4 |
1.7 |
2.0 |
5.3 |
0.8 |
|
|
Japon |
0.4 |
1.4 |
-0.1 |
0.8 |
1.7 |
1.0 |
|
Solde du compte courant (% du PIB) |
États-Unis |
-3.9 |
-5.8 |
-2.8 |
-2.3 |
-3.6 |
-3.2 |
|
|
Chine |
1.3 |
9.3 |
1.8 |
1.6 |
1.8 |
1.5 |
|
|
UE (Allemagne) |
0.1 |
6.4 |
6.1 |
8.5 |
7.9 |
6.9 |
|
|
Japon |
2.1 |
3.9 |
1.9 |
3.9 |
3.0 |
3.5 |
|
Coût unitaire de la main-d’œuvre (2015=100) |
États-Unis |
90.1 |
96.5 |
98.2 |
100.2 |
105.8 |
110.1 |
|
|
Chine |
115.2 |
98.7 |
95.4 |
101.5 |
103.1 |
104.5 |
|
|
UE (Allemagne) |
98.5 |
98.9 |
99.1 |
99.8 |
102.3 |
105.6 |
|
|
Japon |
106.3 |
102.1 |
104.5 |
99.7 |
99.5 |
100.2 |
|
Autosuffisance énergétique (%) |
États-Unis |
72 |
70 |
83 |
87 |
101 |
105 |
|
|
Chine |
94 |
88 |
85 |
84 |
82 |
80 |
|
|
UE |
60 |
56 |
54 |
54 |
60 |
62 |
|
|
Japon |
12 |
11 |
6 |
8 |
11 |
13 |
Note : Les données sont des valeurs représentatives compilées à partir de sources publiques, notamment le FMI, la Banque mondiale, l’OCDE, l’EIA et les agences statistiques nationales. Les données de l’UE utilisent l’Allemagne comme exemple représentatif.
2.2 Le dilemme du paria : affronter et réintégrer les États révisionnistes
Cette section analyse la Russie comme une étude de cas. Le régime de sanctions actuel imposé à la Russie est le plus complet jamais appliqué à une grande économie.
- Impact sur la Russie : Les sanctions ont privé la Russie de centaines de milliards de dollars de revenus et ont bloqué l’accès aux technologies critiques. Cependant, l’économie russe a fait preuve de résilience grâce à la substitution des importations, aux exportations de pétrole via une « flotte fantôme » et à la réorientation du commerce vers des pays non sanctionnateurs comme la Chine et l’Inde.
- Impact mondial : Les sanctions ont provoqué de graves perturbations sur les marchés mondiaux de l’énergie, des denrées alimentaires et des engrais, avec un impact disproportionné sur les pays en développement.
Pour formuler une stratégie efficace face à ce défi, nous analysons les précédents historiques.
- Afrique du Sud : La fin de l’apartheid démontre qu’une pression internationale soutenue combinée à des dynamiques internes peut entraîner un changement politique, suivi d’une réintégration rapide dans l’économie mondiale. La clé ici était l’existence d’un état final politique clair (la démocratie) qui offrait une voie vers la normalisation.
- Iran (JCPOA) : L’accord sur le nucléaire est un excellent exemple d’un modèle basé sur la performance, liant directement des actions vérifiables à un allégement des sanctions. Même un allégement partiel des sanctions a procuré des avantages économiques importants, prouvant le pouvoir des incitations. En même temps, la fragilité de l’accord offre des leçons sur l’importance de l’engagement politique.
- Le défi de la reconstruction : L’ampleur de la destruction en Ukraine est immense, avec des coûts de reconstruction estimés à plus de 524 milliards de dollars. Le débat sur l’utilisation des avoirs russes gelés pour financer cette reconstruction sera une question centrale dans tout règlement futur, liant directement la responsabilité russe à la reprise de l’Ukraine.
La stratégie actuelle envers la Russie manque d’un état final clair. Des sanctions indéfinies risquent de cimenter de manière permanente un bloc eurasien hostile (Russie-Chine-Iran) et d’accélérer la fragmentation du système financier mondial. Une stratégie réussie doit passer de la simple punition à la « diplomatie coercitive », en utilisant les sanctions comme levier pour parvenir à un règlement politique clair. Cela nécessite une « porte de sortie » claire, crédible et soutenue au niveau international, qui lie des changements vérifiables dans le comportement russe à un processus de normalisation progressif. La situation actuelle, où les sanctions sont efficaces mais pas décisives, crée une impasse dangereuse. Le cas sud-africain suggère que les sanctions fonctionnent mieux comme levier pour une transition politique. L’accord sur le nucléaire iranien fournit un modèle pour une approche « transactionnelle », échangeant des étapes vérifiables contre des récompenses concrètes. Appliquer cette logique à la Russie signifie passer de l’état binaire actuel de « toutes les sanctions ou aucune sanction » à un cadre progressif et conditionnel. C’est le seul moyen de maintenir la pression tout en garantissant la responsabilité pour l’Ukraine et en créant des incitations au changement au sein de la Russie.
2.3 Le vide de gouvernance : maîtriser l’épée à double tranchant de la technologie
Cette section analyse le système dual de gouvernance technologique proposé par l’utilisateur.
- Le bien commun de l’open-source : Le logiciel open-source (OSS) est un bien public mondial essentiel, constituant la base de presque toutes les technologies modernes, du cloud computing à l’IA, avec une valeur économique estimée du côté de la demande de 8,8 billions de dollars. Cependant, ce bien commun est menacé par un sous-investissement dans la maintenance et la sécurité, créant des risques systémiques. La vulnérabilité Log4Shell est un excellent exemple de la manière dont une faille dans un composant obscur, maintenu par des bénévoles, peut mettre en danger l’ensemble de l’infrastructure numérique mondiale.
- Le bouclier du code source fermé : Simultanément, la sophistication et la nature transnationale de la cybercriminalité — des gangs de rançongiciels aux pirates informatiques parrainés par l’État — dépassent les capacités des agences nationales d’application de la loi. La coopération internationale par le biais d’organismes comme INTERPOL et Europol est essentielle, mais elle est souvent entravée par des systèmes juridiques différents et des retards dans le partage d’informations. Une organisation mondiale experte et technologiquement supérieure est nécessaire pour contrer efficacement ces menaces transfrontalières.
Le défi principal ici est de savoir comment créer un organe centralisé, puissant et responsable pour contrôler les abus qui découlent du monde de l’open-source, tout en préservant sa nature innovante, décentralisée et sans autorisation. Cela reflète le problème classique de la philosophie politique de l’équilibre entre la liberté et la sécurité à l’ère numérique.
L’approche actuelle de la gouvernance numérique est dangereusement fragmentée. Nous tentons de réglementer un monde numérique mondial et instantané avec des cadres juridiques nationaux du XXe siècle. La proposition de l’utilisateur identifie correctement la nécessité d’une nouvelle architecture mondiale à deux niveaux : une couche qui agit comme un « gardien » pour le bien commun numérique productif (OSS), et une autre qui agit comme un « exécuteur » contre les forces destructrices qui l’exploitent. Ces deux fonctions sont symbiotiques. L’innovation ne peut prospérer que si le bien commun est sécurisé. L’OSS crée une immense valeur mais est confronté au risque d’une « tragédie des biens communs ». Cela nécessite un modèle de gestion, avec un financement public-privé pour les infrastructures critiques. La cybercriminalité, d’autre part, est une menace mondiale et organisée qui exige une réponse organisée et puissante. Une force de police cybernétique mondiale doit maintenir un avantage technologique sur ses adversaires, ce qui signifie des outils propriétaires à code source fermé. Les deux propositions sont les deux faces d’une même pièce : l’une nourrit le bien, l’autre réprime le mal, créant un écosystème numérique équilibré.
Partie 3 : Un plan pour une nouvelle ère : les percées proposées
Cette section centrale présente des prescriptions concrètes issues de l’analyse précédente, répondant directement à la requête de l’utilisateur avec des propositions détaillées et réalisables, ancrées dans l’analyse précédente.
3.1 Proposition 1 : L’Accord de stabilité économique mondiale (GESA) — Un cadre du XXIe siècle pour une coexistence gérée
- Concept : Un nouveau cadre multilatéral, envisagé pour fonctionner sous l’égide du G20, conçu pour gérer la concurrence structurelle entre différents modèles économiques et prévenir les déséquilibres déstabilisateurs. Il ne s’agit pas d’un retour à un système fixe comme celui de Bretton Woods, ni d’une simple répétition de l’Accord du Plaza, mais d’un système dynamique de coordination des politiques.
- Composants clés :
- Panier de surveillance élargi : Suivi d’un ensemble plus large d’indicateurs au-delà des simples balances commerciales et des taux de change. Cela inclurait les excédents/déficits courants en pourcentage du PIB, les taux d’épargne et d’investissement nationaux, les niveaux de subventions industrielles (s’inspirant des propositions de réforme de l’OMC), la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et l’intensité carbone des exportations (en lien avec des mécanismes comme le MACF).
- Transparence et examen par les pairs : Les États membres s’engagent à une communication transparente sur ces mesures, soumise à un examen par les pairs par un organe technique conjoint du G20, du FMI et de l’OMC. Cela permettrait de remédier à l’opacité actuelle des politiques de subventions.
- Mécanisme d’ajustement coordonné : Lorsque les mesures dépassent des seuils préétablis, un dialogue structuré est déclenché, obligeant les membres à négocier un ensemble d’ajustements politiques. Cela pourrait inclure des interventions monétaires coordonnées, l’élimination progressive de subventions spécifiques, des investissements conjoints dans la diversification des chaînes d’approvisionnement et le lien entre les préférences commerciales et les engagements climatiques.
- Justification : Le GESA reconnaît que la stabilité économique mondiale ne peut plus être un sous-produit accidentel de politiques nationales non coordonnées. Il crée un processus formel pour gérer l’interdépendance et prévenir les politiques de « chacun pour soi » qui conduisent à des guerres commerciales et à l’instabilité.
Tableau 2 : Cadre de l’Accord de stabilité économique mondiale (GESA)
|
Pilier |
Objectif |
Indicateurs clés |
Mécanisme/Forum |
Acteurs clés |
|
1. Stabilité macro-financière |
Corriger la volatilité excessive des taux de change et les déséquilibres mondiaux |
Solde du compte courant (% du PIB), Taux de change effectif réel, Réserves de change |
Réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, surveillance annuelle du FMI |
G20, FMI, Banques centrales nationales |
|
2. Politique industrielle et commerciale |
Garantir des conditions de concurrence équitables et prévenir les courses aux subventions néfastes |
Niveaux de subventions par secteur, Part des entreprises publiques dans l’économie nationale, Barrières à l’accès au marché |
Réunions des ministres du Commerce du G20 sur la base de rapports conjoints OMC/OCDE, Règlement des différends pour les violations majeures |
G20, OMC, OCDE |
|
3. Sécurité des chaînes d’approvisionnement et des ressources |
Diversifier et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement critiques |
Dépendance vis-à-vis de pays spécifiques pour les minéraux critiques, Part de production des technologies clés |
Partenariat élargi pour la sécurité des minéraux dirigé par le G20, Mécanismes conjoints de stockage et d’investissement |
G7/G20, AIE, Entreprises concernées |
|
4. Lien climat-commerce |
Prévenir la fuite de carbone et aligner les objectifs climatiques mondiaux sur les règles commerciales |
Intensité carbone des exportations, Prix nationaux du carbone |
Création d’un forum de négociation multilatéral sur le MACF, Soutien technique/financier aux pays en développement |
G20, CCNUCC, OMC |
3.2 Proposition 2 : Une feuille de route basée sur la performance pour la réintégration de la Russie
- Concept : Une feuille de route formelle et en plusieurs étapes pour sortir de l’impasse actuelle des sanctions. Elle crée une voie conditionnelle pour la normalisation de la Russie en liant des actions russes spécifiques et vérifiables à des actions réciproques de la communauté internationale. Cela maintient une pression maximale tout en offrant une « porte de sortie » claire.
- Composants clés :
- Création de l’Autorité pour la reconstruction et les réparations de l’Ukraine (URRA) : Un organe supervisé au niveau international, coprésidé par l’Ukraine, le G7 et un État neutre (par exemple, la Suisse), pour gérer tous les fonds de reconstruction. Son financement initial proviendrait des bénéfices générés par les avoirs souverains russes gelés, comme cela commence déjà à se produire.
- Allégement progressif des sanctions : Une feuille de route détaillée liant les actions russes au dégel des avoirs et à la levée des sanctions. Ce serait transactionnel et réversible.
- Architecture de sécurité : Dans la phase finale, des négociations pour un nouveau traité de sécurité européen, incluant des limitations sur les déploiements de forces et de nouveaux mécanismes de vérification, pour traiter les causes profondes du conflit.
- Justification : Cette proposition déplace la dynamique de la punition à la résolution. Elle s’inspire des approches conditionnelles et basées sur la performance du JCPOA et de l’Afrique du Sud post-apartheid en faisant dépendre la réintégration de la Russie de sa contribution à la résolution du problème qu’elle a créé (la reconstruction de l’Ukraine).
Tableau 3 : Feuille de route pour la réintégration de la Russie
|
Phase |
Actions russes requises (vérifiables) |
Allégement des sanctions/incitations correspondants |
Rôle de l’URRA |
Objectif de sécurité à long terme |
|
Phase 1 : Cessez-le-feu et retrait |
Respect d’un cessez-le-feu complet, retrait vérifié de toutes les forces du territoire ukrainien |
Suspension temporaire de certaines sanctions financières (par exemple, reconnexion partielle à SWIFT), assouplissement des restrictions sur les importations humanitaires |
Coopération avec les observateurs du cessez-le-feu, réalisation des premières évaluations des dommages |
Rétablissement des missions de surveillance de l’OSCE |
|
Phase 2 : Responsabilité et réparations |
Coopération totale avec les tribunaux internationaux pour crimes de guerre, transfert de la majorité des avoirs gelés sous le contrôle de l’URRA |
Déblocage partiel des avoirs non souverains, autorisation de réintégrer certains forums internationaux (par exemple, organismes scientifiques) |
Réception des avoirs gelés et début de l’allocation des projets de reconstruction |
Mise en place d’un mécanisme international garantissant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine |
|
Phase 3 : Normalisation et nouvelle sécurité |
Reconnaissance totale de la souveraineté ukrainienne, signature et ratification d’un nouveau traité de sécurité européen |
Levée progressive des sanctions économiques restantes, pourparlers en vue d’un retour au G8/G20 |
Mise en œuvre à grande échelle des projets de reconstruction et coordination de la coopération économique à long terme |
Entrée en vigueur d’un nouveau traité de sécurité européen incluant des mesures de confiance et de contrôle des armements |
3.3 Proposition 3 : L’initiative pour les biens communs numériques et le bouclier mondial de cybersécurité
- Concept : Un modèle de gouvernance à deux niveaux pour gérer la technologie mondiale, répondant à l’appel de l’utilisateur à séparer les technologies générales/commerciales et de sécurité.
- Niveau 1 : La Fondation pour les biens communs numériques (DCF)
- Mission : Agir en tant que gardien mondial des logiciels open-source critiques et de l’infrastructure numérique.
- Structure : Un consortium public-privé financé par les gouvernements nationaux (contribuant en fonction du PIB) et les grandes entreprises technologiques.
- Fonctions : Financement de la maintenance professionnelle et à temps plein et des audits de sécurité pour les projets OSS critiques ; établissement de normes pour le développement de logiciels sécurisés ; fourniture d’un forum neutre pour la résolution des litiges sur la gouvernance de l’OSS.
- Justification : Cela institutionnalise la protection d’un bien public mondial vital, atténuant le risque d’une « tragédie des biens communs » et garantissant la stabilité de l’économie numérique dont dépendent toutes les nations.
- Niveau 2 : L’Agence mondiale contre la cybercriminalité (WCA) – « Le Bouclier »
- Mission : Enquêter, perturber et démanteler de manière proactive les réseaux transnationaux de cybercriminalité (rançongiciels, fraude financière, financement du terrorisme).
- Structure : Un organe opérationnel agissant sous un mandat élargi d’INTERPOL, composé d’experts en cybersécurité d’élite détachés des États membres.
- Capacités : Possède sa propre plateforme d’analyse de renseignements propriétaire et à code source fermé, exploitant l’IA et la fusion de données. Cette technologie serait développée conjointement mais maintenue sous un contrôle international strict pour empêcher la prolifération et garantir la responsabilité. La WCA aurait une autorité coordonnée pour saisir les actifs numériques illicites (par exemple, les crypto-monnaies) au-delà des frontières.
- Justification : Cela crée un « exécuteur » mondial doté de la supériorité technologique et de l’autorité légale pour poursuivre les criminels au-delà des frontières, surmontant les limites des agences nationales individuelles. La nature à code source fermé de ses outils est essentielle pour maintenir un avantage opérationnel sur les adversaires.
Conclusion : De la concurrence sans contrainte à la coexistence gérée
La synthèse de l’analyse et des propositions de ce rapport conduit à une seule conclusion : l’ère de la mondialisation guidée par une « main invisible » est terminée. Le défi décisif du prochain quart de siècle est de construire une architecture pour un monde de concurrence persistante et ouverte.
Les trois initiatives proposées — le GESA, la feuille de route pour la réintégration de la Russie et l’initiative de gouvernance numérique — ne sont pas présentées comme des solutions autonomes, mais comme trois piliers fondamentaux et interdépendants d’un nouveau système international plus résilient.
Ce rapport se conclut sur une note d’optimisme réaliste. Un retour à un ordre unipolaire est impossible, et un consensus mondial harmonieux est peu probable. Cependant, un avenir stable basé sur une coexistence gérée, des règles d’engagement claires et une coopération solide sur les menaces existentielles partagées est à la fois nécessaire et réalisable.
引用文献
- Supply Chain Disruptions, Trade Costs, and Labor Markets – San …, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.frbsf.org/research-and-insights/publications/economic-letter/2023/01/supply-chain-disruptions-trade-costs-and-labor-markets/
- China’s Role in Supply-Chain Strategies | MSCI, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.msci.com/research-and-insights/blog-post/china-role-in-supply-chain-strategies
- The trade balance and the real exchange rate – BIS Quarterly …, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1109e.pdf
- Country Case Studies (Part II) – Industrial Policy for the United States, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/books/industrial-policy-for-the-united-states/country-case-studies/84D7065CEDE486DCB4E035B5397DF5D9

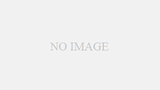
コメント